Fondation Biosphère et Société
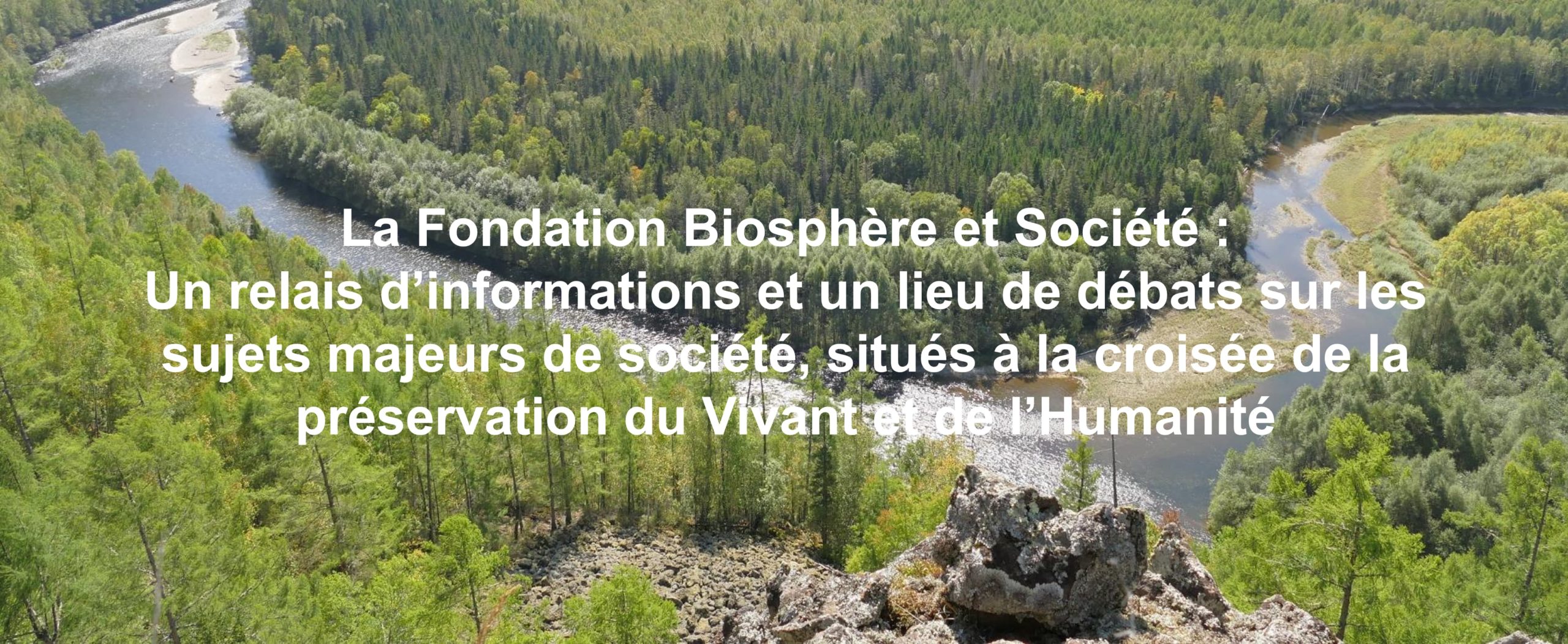
Vous souhaitez être informé des nouvelles publications ? Inscrivez-vous au moyen de ce formulaire
Page LinkedIn de la Fondation
N’hésitez pas à vous abonner et à contribuer aux débats sur cette plateforme !
Rappel à production littéraire
Recension
| MARTIN, Jean (2025) : La lutte enchantée. DION, Cyril(2025)
Une écologie qui donne envie ? Sous l’impulsion de Cyril Dion |
| Dix ans déjà ! A la surprise de tout le monde, en premier lieu de ses auteurs, le documentaire « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, a eu un succès quasi-planétaire, en tout cas largement international.
Devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, ce film a la particularité de ne pas donner dans le catastrophisme et de garder espoir, dans un monde qui bascule. Sur un fonds plutôt optimiste, il présente des initiatives prises dans une dizaine de pays, en réponse aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, en matière d’agriculture, d’énergie, d’économie, d’éducation et de gouvernance. |
| MARTIN, Jean (2025) : Une vie pour la nature. PERROT, Julien (2025)
Quand la nature devient … un art de vivre |
| Comment Julien Perrot vit pour La Salamandre
Il n’est pas besoin d’être un passionné de nature pour avoir entendu parler, depuis plus de trente ans, de Julien Perrot. Attiré viscéralement dès l’enfance par la nature, les animaux et végétaux qui y vivent – tout dans la nature ! – il a créé vers l’âge de dix ans, pour son école, La Salamandre, petit journal issue de cette passion – entretenue avec et malgré un handicap visuel incomplètement corrigé. A vingt ans, après avoir hésité à s’engager en faculté des lettres, Julien s’est dirigé vers les sciences de la vie, en couplant son plaisir d’écrire à la connaissance et à la rigueur scientifiques. |
Points de vue
| MARTIN, Jean (2025) : Sentiment océanique … |
| Dans ce texte concis et inspirant, l’auteur partage son vécu de moments exceptionnels où, comme Sophie Swaton le développe dans son ouvrage « L’œil du jaguar – Voyage philosophique au coeur de la conscience », l’individu peut côtoyer à certaines occasions un sentiment de complétude extrême, relevant du paranormal. Ce sentiment qu’il qualifie « d’océanique » le fait se rapprocher du bonheur plein.
Pour mémoire, Jean Martin est l’auteur d’une recension d’un ouvrage de Fourier traitant de la dégradation de l’environnement, commenté récemment par Swaton, et mise en ligne sur le site de la Fondation. |
Actualités
| Conte de la grâce du monde – une égéographie. ROCHET-BIELLE, Florian (2025) |
| À l’occasion de la première du spectacle « Une baleine dans le Léman », soutenu par la Fondation, a été présenté le 14 octobre, au théâtre Le Châtelard (Ferney-Voltaire), l’ouvrage de Florian Rochet-Bielle « Conte de la grâce du monde », illustré par Dominique de Haan. Cet ouvrage d’écopoétique est le premier de la collection SEBES Pocket créée par la Fondation et accueillie par Georg Editeur. Il est désormais disponible en librairie et directement auprès de ce dernier. |
| Une baleine dans le Léman |
| La Fondation est heureuse et honorée d’avoir été associée à la réalisation de ce très beau projet multiculturel qui s’est déroulé au cours de l’été sous la forme de réalisations variées dans leurs contenus et dans leurs supports ; elle vous invite à revivre les principaux moments dans les podcasts disponibles sur l’une ou l’autre des plateformes ci-après : Audioblogs, ARTE Radio /Spotify/Deezer /Apple Podcasts
Voir également : Bande annonce et Une baleine dans le Léman (écoutes au lac) Elle remercie les réalisateurs de ce projet, poètes, artistes, historiens, naturalistes et pêcheurs qui, chacun(e) à sa façon, a su partager … un bout de cette baleine et nous a permis de nous laisser porter par les eaux du Léman au cours d’un cheminement écologique et imaginaire à la fois, fouettant nos esprits et nos cœurs. La Fondation est également reconnaissante aux collectivités et associations qui ont accepté de monter sur ce bateau ivre de poésie, mélodies et autres contributions littéraires et artistiques, en route vers le cap d’une synthèse heureuse entre Nature et Culture à laquelle elle est particulièrement attachée. |
Points de vue
| LETHIER, Hervé (2025) : Du plomb dans l’aile de l’agro-industrie française ? |
| Promulguée le 11 août par le Président Macron après une censure partielle du Conseil constitutionnel, la Loi dite « Duplomb » du nom de son porteur originel, vise à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ».
Résultant d’un débat législatif à tout le moins chaotique, tronqué et politiquement surprenant, cette Loi est loin de faire l’unanimité au sein de la classe politique française. Votée par l’Assemblée nationale le 18 juillet dernier par 316 voix (Droite et Rassemblement national) contre 223 (Gauche et écologistes), elle fracture y compris le bloc gouvernemental (10 députés macronistes se sont abstenus, tandis que 14 d’entre eux ainsi que 9 députés Modem et 3 Horizons ont voté contre). |
| LETHIER, Hervé (2025) : Le temps se gâte pour les États |
| Le 9 avril 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Suisse pour insuffisance en matière de lutte contre le changement climatique (cf. La Suisse et le changement climatique – un mauvais exemple). C’est aujourd’hui l’ensemble des Etats qui se font rappeler leurs obligations en la matière, par la Cour internationale de justice (CIJ) dont l’avis consultatif unanime de ses membres, du 23 juillet 2025, constitue un moment historique dans l’évolution de la justice climatique. |
| MARTIN, Jean (2025) : Les choses ne vont pas bien … et ce n’est pas le moment d’oublier le climat ! |
| Le vieil observateur de la société – et un peu acteur – que je suis ne sait pas trop quoi dire, ou plutôt par quoi commencer. J’ai été très perturbé, atterré, ces derniers temps par les barbaries dont Gaza est le théâtre. De ces choses qui fichent par terre beaucoup de ce à quoi j’ai cru, avec d’autres, sur la société, et même la civilisation, qui a été construite au cours des dernières décennies, après les horreurs de la deuxième guerre mondiale. Des espoirs fracassés pour ce qui me concerne. |
Articles et recensions récents
| MARTIN, Jean (2025) : Détérioration matérielle de la planète (présenté par Sophie Swaton). FOURIER, Charles |
| Menaces sur la biosphère – Fourier, visionnaire il y a deux siècles
Le non-spécialiste de l’histoire des idées pourra être surpris que le philosophe protéiforme qu’est Charles Fourier, fondateur de l’Ecole sociétaire, théoricien des passions humaines et promoteur de sociétés/lieux du registre socialiste/communautaire, se soit inquiété de la détérioration de notre monde (« planète qui périclite et décline à vue d’œil » !) – parmi tant d’autres sujets qu’il a traités. C’est au crédit des PUF et de Sophie Swaton, qui encadre le texte de Fourier d’une introduction et d’un commentaire substantiel, de nous le rappeler/l’apprendre. |
| LETHIER, Hervé (2025) : Politiques et anthropocène, ou « de la relativité du temps et des idées » |
| Dans un ouvrage consacré à la Biosphère de l’anthropocène paru en 2007, Jacques Grinevald, philosophe français établi à Genève, indiquait que le mot anthropocène était un néologisme dont le champ sémantique se trouvait encore en débat.
Pour faire simple et aux dires de nombreux experts des sciences de la Terre, l’anthropocène conceptualisé par le climatologue Paul Crutzen et son collègue biologiste Eugène Stoermer en 2000, désignerait une nouvelle période géologique ayant succédé à l’holocène depuis la seconde moitié du XIXème siècle, sous la pression de l’humanité. |
| MARTIN, Jean (2025) : Le long combat des Aînées pour le climat. PEARSON, Sevan (2025) |
| Avancées dans la justice climatique – Une publication nécessaire et bienvenue
Il y a un an, le 9 avril 2024, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rendait un arrêt historique condamnant la Confédération helvétique pour manque à ses obligations relativement aux conséquences du changement climatique ; elle donnait ainsi raison aux Aînées pour le climat (Klima-Seniorinnen) qui ont démontré que leur droit n’était pas respecté au risque de menacer leur santé et leurs conditions de vie. Le Parlement, suivi par le Conseil fédéral, s’est alors ridiculisé, arguant que la CEDH avait outrepassé son mandat. Réaction « du chien qui a reçu le caillou », inepte. Réfutant cette décision, la droite tellement attachée à l’Etat de droit, donnait dans la désobéissance civile qu’elle reproche tant aux militants. |





